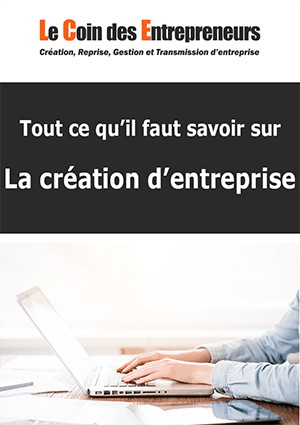Avant de se lancer dans des démarches de création d’une société, il convient de s’intéresser à la forme juridique de cette dernière. En effet, un choix va devoir s’opérer à ce niveau en prenant en compte de nombreux critères : activité de la société, nombre de participants dans le projet… Le point de départ de cette étude consiste à lister toutes les possibilités au niveau de la forme juridique de la future société.
Dans ce dossier, nous allons vous présenter les principales formes juridiques de sociétés de type commercial et de type civil.

Les formes juridiques de sociétés commerciales
Dans la catégorie des sociétés de type commercial, il existe de nombreuses options qui se distinguent assez facilement. Les voici :
- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL), qui peuvent également ne comprendre qu’un seul associé (EURL) ;
- Les sociétés par actions simplifiées (SAS), qui peuvent également ne comprendre qu’un seul associé (SASU) ;
- Les sociétés en nom collectif (SNC) ;
- Les sociétés anonyme (SA) ;
- Les sociétés en commandite simple (SCS) ;
- Les sociétés en commandite par actions (SCA).
Ces sociétés sont de type commercial, cela signifie qu’elles ont pour habitude de réaliser des actes de commerce : achat-revente de biens meubles ou immeubles, location, transport, restauration…
Pour vous orienter vers certaines options, voici quelques différences à prendre en compte entre toutes ces possibilités :
- Les EURL et les SASU ne peuvent compter qu’un seul associé, alors que toutes les autres formes juridiques de société impliquent au moins la présence de deux associés au minimum.
- Les SA sont des sociétés au fonctionnement complexe, utilisées dans le cadre de gros projets.
- Les SNC sont des sociétés risquées, car les associés sont indéfiniment responsables.
- Le régime de sécurité sociale des indépendants est accessible uniquement aux dirigeants majoritaires de SARL et aux dirigeants de SNC. Dans les sociétés par actions, les dirigeants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Les formes juridiques de sociétés civiles
En plus des formes juridiques de sociétés commerciales, il existe également plusieurs formes juridiques de société dites « civiles ». Juridiquement, il s’agit de tous les types de sociétés à caractère non-commercial. Ces dernières sont régies par le Code civil. Dans la catégorie des sociétés civiles, nous retrouvons principalement :
- Les sociétés civiles immobilières (SCI) ;
- Les sociétés civiles de construction-vente (SCCV) ;
- Les sociétés civiles professionnelles (SCP) ;
- Les sociétés civiles patrimoniales.
Les SCI sont des structures civiles relativement connues, qui sont employées pour la gestion d’un patrimoine immobilier. Nous insistons bien sur le fait que le terme « gestion » ne signifie pas l’achat et la revente de biens immobilier, mais plutôt l’acquisition, la propriété, la gestion, l’administration et la mise en location de biens immobiliers.
Les sociétés civiles professionnelles permettent, quant à elles, à plusieurs professionnels de se regrouper en vue d’exercer en commun une profession libérale. Les associés de ce type de société sont obligatoirement des personnes physiques. De plus, une personne physique ne peut être associée que d’une seule SCP.
Le choix de la forme juridique d’une société
Le choix de la forme juridique d’une future société est une étape importante de la préparation d’un projet de création d’entreprise. Souvent, les porteurs de projet ont besoin de renseignements et de se faire accompagner pour trouver la solution la plus adaptée à leur projet. À ce niveau, il ne faut donc pas négliger les conseils que pourraient proposer un professionnel tel qu’un expert-comptable, un notaire ou un avocat.
La sélection de la forme juridique d’une future société s’opère en tenant compte d’un certain nombre de critères. En apportant des réponses à chaque point soulevé, on s’oriente naturellement vers la solution la plus appropriée. Parmi les critères généraux, nous retrouvons notamment :
- La nature de l’activité de la société, qui permet de s’orienter vers des sociétés de type commercial ou civil ;
- Le nombre de participants au projet de création d’entreprise, qui distinguera les sociétés à un ou plusieurs associés ;
- La nécessité ou non de créer différentes catégories d’actions, lorsque les associés ont des objectifs différents (par exemple lorsqu’il y a à la fois des investisseurs et des associés actifs) ;
- La régime de sécurité sociale des dirigeants de la société.